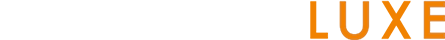|
|

|
|
Depuis 2017, la maison Dior n’en finit pas de célébrer les 70 ans de sa fondation. A Paris, ce fut l’éblouissante exposition du Musée des Arts Décoratifs (5 juillet 2017-7 janvier 2018) qui présenta Dior en « couturier du rêve ». Puis le MUCEM prit le relais avec son Voyage au fil de l’Or (25 avril 2018-10 septembre 2018). À la villa Les Rhumbs de Granville, maison familiale du couturier devenue musée Christian Dior, la présentation « Grace Kelly, princesse en Dior » expose cet été les 90 robes conservées au Palais de Monaco qui parlent des passions communes entre Dior et la Princesse : la passion pour les fleurs et les jardins autant que l’élégance et le raffinement (du 27 avril au 17 novembre 2019). Enfin, le Victor & Albert Museum de Londres, temple de la plus vaste collection de robes historiques au monde et écrin archivistique de la haute couture, accueille depuis le 2 février dernier l’exposition Dior, Designer of Dreams, sur la base de la scénographie parisienne, réinventée à la faveur de son contexte londonien. Prolongée de quelques mois encore jusqu’en septembre 2019, contre toute attente et pour le plaisir de foules insatiables, l’exposition célèbre à sa manière les liens étroits de Christian Dior avec l’Angleterre. Anglophile déclaré, il habille la famille royale, notamment la princesse Margaret, sœur cadette d’Elizabeth, pour qui il crée la robe de ses 21 ans. Il chausse la reine Elizabeth le jour de son couronnement. Il accompagne de ses créations les « débutantes » et autres jeunes princesses pour leur entrée dans le monde (Emma Cockburn en 1953), leurs fiançailles ou leur mariage (Jane Stoddart en 1953).
À Londres comme à Paris, depuis 1947, on n’a d’yeux que pour lui. Sa muse britannique : Jean Dawnay, alias « Caroline », devenue Princesse Galitzine. Elle est son mannequin en 1949-1950, quintessence de l’Englishness pour lui, pièce centrale de son premier défilé outre-Manche, à l’hôtel Savoy, en avril 1950. Jean Dawney, c’est l’incarnation du « New look » inventée par Dior, une taille cintrée à l’extrême, une silhouette allongée, une élégance sophistiquée. Une ligne surtout, celle des actrices hitchcockiennes dans la période britannique du cinéaste : Marlène Dietrich dans Le Grand Alibi (1949), Ingrid Bergman dans Notorious (1948) ou encore l’iconique Grâce Kelly dans Fenêtre sur cour (1954), à qui Dior dessinera la robe de fiançailles en 1956. Princesses britanniques ou actrices hollywoodiennes, qu’importe. Pourvu qu’elles soient en Dior. Car pour Dior ou pour Hitchcock, les femmes sont belles, que dis-je, parfaites. Impeccables. Sophistiquées. Immaculées.
Ont-elles pour autant l’âme de leur plasticité ? Entre Dior et Hitchcock (dont on aura remarqué la similaire bonhommie physique), Reynolds Woodcock se tient là. Plus énigmatique, plus séduisant, disons-le. Il est ce personnage fictionnel de Paul Thomas Anderson, irrésistiblement incarné par Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread (2018). Couturier londonien, œuvrant dans son hôtel particulier de Fitzroy Square, non loin du célébrissime Savile Row, antre de l’autre couturier mythique Harry Amies, le personnage de Reynolds Woodcock est inspiré de l’espagnol Cristóbal Balenciaga – « notre maître à tous », disait Dior – mais aussi des Normann Hartnell, Charles James ou John Cavanagh. Le Londres des années 1950 multiplie les ateliers de haute couture là où, à Paris, Dior règne en empereur au 30 avenue Montaigne. Pourtant, l’ambiance est la même. Fourmilière de blouses blanches, travaillant en silence le temps ordinaire. Défilés les après-midi : murs lambrissés, lustres en cristal, étroitesse des couloirs dans les hôtels particuliers peuplés de clientes assises, mannequins au visage impassible, portant de petits cartons avec des numéros, défilés réglés comme un spectacle, ambiance capitonnée. La ligne reste celle des années cinquante.
Alma Elson (Vicky Krieps) en est la muse. Elle a du modèle la perfection des mesures. Elle en porte les drapés, amples et travaillés. Alma est, à sa manière, la sœur des héroïnes hitchcockiennes. La sœur des Marnie, Rebecca, Melanie, Alicia. Face à l’obsessionnel travaillomane qu’est Reynolds, maniaque, superstitieux et psychorigide, Alma se dévoile empoisonneuse. Avec froideur et calcul, derrière un sourire faussement ingénu, elle trame le souper fatal, manie le poison avec virtuosité, agit lentement dans son dessein de toxicité. Elle a des âmes hitchcokiennes le savoir-faire diabolique. A côté des espionnes, des voleuses, des psychopathes et des machiavéliques, elle est l’empoisonneuse de rêve, incarnation du glamour fifties. Elle est aussi sublime qu’elle est sombre. Une femme fatale, qui, à en croire l’actualité muséale et cinématographique de cette fin des années 2010, interroge encore notre contemporanéité et fascine. Perfection plastique et sombre duplicité, essence éternelle de l’ambivalence féminine…
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de Diable
Qui a mis cette rose au jardin que voilà
Est-ce l’un, est-ce l’autre, vraiment je ne sais pas
Mais pour tant de beauté, merci, et chapeau bas ! (Barbara)