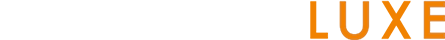|
|

|
|
L’expression de « Galaxie Chanel » n’a jamais été aussi juste qu’en ce lundi 6 octobre au soir. Matthieu Blazy était le dernier « petit nouveau » à s’élancer dans la Fashion Week parisienne. Et sa première collection était aussi la plus attendue. Quelle serait sa version du style Chanel ? Un hommage au règne de Karl Lagerfeld ? Une rupture avec la régence de Virginie Viard ? Là où tant d’autres de ses confrères ont eu à cœur de revisiter les archives de leurs nouvelles maisons, Matthieu Blazy a choisi une voie plus radicale. Sous la verrière du Grand Palais transformée en cosmos, il a dévoilé une collection qui renoue avec l’esprit fondateur de Chanel. Celui d’une élégance libre, vivante, et ancrée dans le mouvement du monde.
La silhouette Chanel vue par Matthieu Blazy
« Deux voies s’offraient à nous. Soit nous faisions un défilé Chanel propre, moderne, respectant les codes, suivant le manuel. Un premier pas. Soit nous faisions ce défilé comme s’il s’agissait du dernier. J’ai choisi la seconde option. »
Les mots confiés par Matthieu Blazy à Tim Blanks du Business of Fashion, en amont du défilé, en disent long sur l’état d’esprit du nouveau directeur artistique de Chanel. Et effectivement, dès les premiers passages, Blazy impose le ton d’une élégance abolie de tout maniérisme. Exit la panoplie Chanel. Les silhouettes s’ancrent dans une réalité tangible. Des tailleurs légers en tweed aux épaules souples, des chemises d’homme Charvet métamorphosées en blouses, des jupes fendues qui révèlent la jambe sans jamais tomber dans la provocation.

Le défilé se structure dans une conversation entre rigueur et sensualité. Et il déroule une série de gestes précis. On identifie immédiatement le tailleur revisité dans une attitude contemporaine. On retrouve les robes fluides à la coupe chemise. Et le tweed, talisman Chanel par excellence, se décline de façon ludique jusqu’à devenir transparent.
L’ensemble est dans la retenue, et il traduit l’humilité d’un créateur qui a conscience d’entrer dans une maison de référence. Mais ce premier défilé Chanel de Matthieu Blazy prouve aussi sa capacité à purifier les codes traditionnels. Il se débarrasse avec justesse de tout ornement excessif, jusqu’au logo Chanel qui s’efface pour laisser la place à la silhouette. Rien n’est figé, tout est en mouvement. Chanel, sous la main de Blazy, redevient un style de vie avant d’être une mode.
Lagerfeld, Viard : le poids de l’héritage
Comparer Matthieu Blazy à ses prédécesseurs relève presque du passage obligé. Et pour cause : ils n’ont pas été nombreux, en 119 ans, à prendre le relais de Gabrielle Chanel.

Pendant trois décennies, Karl Lagerfeld a orchestré la mise en scène du mythe Chanel tel qu’on le connaît maintenant. Ses défilés-spectacles et ses collections aux thèmes riches ont façonné une identité baroque, parfois théâtrale, où le tweed devenait costume. Virginie Viard, en revanche, a cherché à adoucir cette flamboyance. Et sous son mandat, elle a ramené Chanel à une féminité plus quotidienne, plus tendre, quitte à être jugée trop sage.
Matthieu Blazy s’inscrit dans une autre logique. Il ne cherche ni la rupture spectaculaire ni la continuité linéaire. Il opère par une forme de décantation. Et en retirant les couches accumulées, il met à nu la structure essentielle du style Chanel. La clarté des lignes, la fonction de chaque forme, l’idée du confort au service de la beauté.
Gabrielle Chanel en sa maison
Si cette première collection résonne avec tant de justesse, c’est qu’elle rétablit un dialogue interrompu avec Gabrielle Chanel elle-même.
Un exemple avec les chemises Charvet, portées sur des jupes fendues. Le choix peut sembler incongru. Et pourtant, il rappelle directement les silhouettes que Chanel aimait porter dans les années 1920, quand elle empruntait les vêtements de son grand amour, Boy Capel, lui-même client de Charvet. Il s’agit donc bien d’un retour à l’essence du geste Chanel, celui qui consiste à faire du vêtement masculin un outil de liberté féminine.

Dans plusieurs passages, on retrouve l’idée du mouvement permanent : les vestes ouvertes, les manches retroussées, les étoffes qui accompagnent le pas. Gabrielle Chanel détestait le corset et ses contraintes. Matthieu Blazy, à sa suite, rend au corps de la femme sa pleine autonomie.
Mémoire et création : redéfinir le rôle du créateur dans la mode contemporaine
Cette collection fait écho à une question qui irrigue la mode actuelle : qu’est-ce qu’un directeur artistique aujourd’hui, dans une maison de mode patrimoniale ?
Depuis environ une décennie, la mode semble devenue une machine à archives. Et chaque créateur est sommé de revisiter, de réinterpréter, de citer. La création s’est transformée en curation permanente. Comme si une maison de mode n’était rien d’autre qu’un espace muséal. Et avec son premier défilé chez Chanel, Matthieu Blazy refuse de tomber dans ce piège.

Sa démarche ne consiste pas à convoquer les icônes du passé pour flatter la mémoire collective et la perception que le public actuel a de la marque. Blazy préfère plutôt explorer les zones d’ombre de l’histoire. Les éléments perdus de vue, et qui ont pourtant fondé la modernité de Chanel. Ce n’est plus une mode de la citation, mais une mode de la mémoire. Autrement dit : il est plus important d’honorer l’esprit que de proposer une énième lecture littérale de l’œuvre de Chanel.
Et en renouant avec Gabrielle plutôt qu’avec Lagerfeld, Matthieu Blazy rappelle au monde de la mode que le véritable hommage ne consiste pas à répéter, mais à continuer de créer.
À lire aussi :
- Dior : Jonathan Anderson peut-il réinventer sans trahir ?
- Sarah Burton chez Givenchy : renouer avec la culture de la couture française
- Saint Laurent : Anthony Vacarello impose un vestiaire de pouvoir
- Balenciaga : Piccioli ramène la maison à ses racines
- Lanvin : la plus ancienne maison de mode est-elle encore pertinente ?