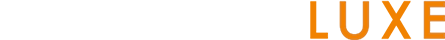|
|

|
|
Jamais aucune Fashion Week n’avait été à ce point marquée par la rupture que l’édition 2025 qui vient de se refermer. Et pour cause : le nombre de directeurs artistiques présentant leurs premières collections était anormalement élevé. Car même dans un milieu où le mercato de la mode se joue chaque saison, ce reboot général n’a pas manqué d’insuffler un nouvel élan à un marché du luxe morose depuis le début d’année 2025.
Or la nouveauté n’est pas sans poser de questions sur le rôle exact que ces directeurs artistiques doivent jouer dans leurs nouvelles maisons. Continuité ? Cohérence ? Retour aux sources ? Rupture ? L’équilibre entre l’expression personnelle d’un directeur artistique et l’ADN de sa nouvelle maison est difficile à trouver. Encore plus depuis une dizaine d’années, car l’inflation médiatique autour du secteur du luxe a encouragé la culture du buzz. Souvent au détriment des analyses pertinentes. Alors la question se pose : dans un environnement médiatique si prompt au « bashing », de quelle marge de manœuvre créative les couturiers disposent-ils ?
Demna chez Gucci : archétypes ou stéréotypes 2.0 ?
Il était le premier à s’élancer dans la ronde des nouveaux venus. Et celui, aussi, dont la nomination avait fait couler le plus d’encre. Demna a présenté sa première collection Gucci à travers un film et une galerie de personnages. Des « archétypes » comme les a présentés la maison florentine. En fait, des personnages sensés incarner les différentes facettes de la maison. Et de fait, cette « Famiglia » Gucci rappelle le jeu des sept familles : le directeur, la VIP, l’héritière, le nerd…
Un fidèle de Jung, le père des archétypes, ne s’y retrouverait pas. Mais les amateurs de mode, eux, auront compris sans difficulté à quoi cet assemblage de personnages fait référence. Car au fil des portraits, ce sont plutôt les différentes ères du style Gucci qui s’incarnent à travers autant de stéréotypes. Des clés pour entrer dans les périodes historiques successives de la maison. Des codes classiques des années 1960 à la flamboyance des années Michele, sans oublier l’ère sulfureuse de Tom Ford. Le créateur géorgien offre un véritable voyage dans le temps.
La première collection de Demna a été largement saluée. Mais est-ce vraiment un travail de création, ou plutôt une interrogation sur le sens de la création dans une maison saturée de références ? La question se pose d’autant plus que l’empreinte de Demna était finalement assez peu visible dans cette collection Famiglia. Et pour l’instant, cette convocation des portraits du passé ressemble à une stratégie pour ménager son public avant la vraie rupture à venir en 2026.
Dario Vitale chez Versace : à Milan, le reboot a du mal à prendre
Toutes les franchises de films hollywoodiens connaissent bien le principe du reboot. Faire table rase du passé, et reprendre l’histoire depuis le début. Au mois d’août, lorsque le groupe Prada (désormais propriétaire de Versace) a choisi d’effacer la quasi intégralité du fil Instagram de Versace, la décision n’est pas passée inaperçue. Et elle n’a pas manqué de soulever de vives critiques sur les réseaux sociaux. Dans un tel contexte, c’est peu de dire que les fidèles de la maison attendaient la première collection Versace de Dario Vitale avec beaucoup d’intérêt.
Un intérêt qui a rapidement laissé la place à une forme de frustration. Car le défilé n’a pas convaincu. Dans un climat général de scepticisme de la part du public, Vitale n’a pas réussi à convaincre avec sa proposition. Ce que les amateurs de la marque lui reprochent ? De s’être trop éloigné de l’héritage Versace. L’attaque est-elle fondée ? Certes, Dario Vitale a choisi de s’émanciper du pur style de Donatella Versace. Mais il offre un retour au style Gianni Versace. Un reboot esthétique qui ne semble pas convaincre les puristes. À moins que ce ne soit justement cette absence de mémoire de la part du public qui n’ait causé une telle incompréhension face à cette collection ?
L’avènement des réseaux sociaux a favorisé la création d’un imaginaire raboté. L’histoire du luxe, dans sa totalité, n’est pas toujours bien connue des jeunes générations de consommateurs. Et il semble que chez Versace, Dario Vitale ait fait les frais de cet attachement du public à une mémoire trop récente, au détriment de l’ADN historique de la maison. La question que se posent les observateurs est désormais de savoir si cet accueil frileux de la part de la sphère social media découragera ou pas les clientes fidèles à la maison.
Dior et Chanel : les maisons patrimoniales face au jugement populaire
« Do you dare to enter ? » Le court métrage présenté en guise d’introduction au premier défilé féminin Dior de Jonathan Anderson en dit long sur l’état d’esprit du créateur irlandais. Visiblement ému (et soulagé) au moment du salut final, Anderson a pourtant présenté son travail devant un public déjà acquis à sa cause. Rédactrices de mode, prescripteurs d’opinions et influenceurs se souvenaient alors de son premier défilé masculin, quelques mois plus tôt, couronné de succès.
Sous la verrière du Grand Palais, Matthieu Blazy s’est élancé avec moins de certitudes pour sa première collection Chanel. Car personne ne savait ce qu’il allait proposer. Et aucune silhouette n’avait été présentée en amont du défilé. Comme à son habitude, Chanel avait choisi le silence comme stratégie de communication. La surprise était donc totale, et la réaction spontanée au moment du salut du créateur français, lui aussi accueilli par une standing ovation.
Chez Dior comme chez Chanel, les nouveaux directeurs artistiques ont fait le choix de la rupture. Et chacun a eu à cœur d’injecter sa propre sensibilité dans le vestiaire de légende de leurs maisons respectives. Chez Dior, Jonathan Anderson n’a pas hésité à raccourcir le tailleur Bar historique : la jupe remonte désormais là où s’arrêtait la jupe ! Chez Chanel, on découvre pour la première fois les chemises Charvet portées par Gabrielle Chanel, qui n’avaient pourtant jamais été intégrées aux collections de Mademoiselle.
La presse spécialisée a été conquise. Mais sur les réseaux sociaux, des voix dissidentes se sont fait entendre. Dior et Chanel auraient perdu leur identité.
Authenticité pure VS. authenticité perçue
Trop de changements d’un coup ? Peut-être. Et pourtant, il faut reconnaître à chaque créateur un travail minutieux de curation des archives de leurs maisons. Car Jonathan Anderson a bien fondé son travail sur les éléments de l’iconographie traditionnelle de Dior (le tailleur Bar, les nœuds, la coupe New Look). Et Matthieu Blazy a retrouvé un élément authentique du style personnel de Gabrielle Chanel pour nourrir sa propre réflexion.
Alors d’où vient le décalage ? La création est-elle trop radicale ? Il semble plutôt que l’ADN authentique des maisons historiques et leur perception par le public soit en décalage. Dans une récente interview accordée au Monde, Matthieu Blazy évoquait lui-même cet écart creusé avec le temps. « C’est bizarre, mais j’ai juste compris que ce que je connaissais de Chanel était le point de vue de Karl. »
La lassitude qui prédominait depuis environ deux ans dans l’univers du luxe vient enfin d’être rompue. Et pourtant, la réception des premières collections laisse songeur. Certes, l’opinion publique et les comportements des acheteurs du luxe ne coïncident pas. Pourtant, une maison a besoin de soigner sa réputation pour maintenir son attrait auprès de sa clientèle cible. Et une mauvaise publicité, contrairement à l’adage, n’est pas nécessairement une bonne chose.
Les maisons doivent-elles jouer la sécurité et chercher à s’aligner sur la perception que le public a d’elles ? En son temps, Karl Lagerfeld avait déjà tranché le débat, dans son style inimitable : « La vraie modernité, c’est le refus de la nostalgie. »
À lire aussi :