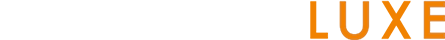|
|

|
|
Sans surprise, la Fashion Week de Paris 2025 n’a pas été avare de spectaculaire. Dès le premier jour, le défilé en soirée de Saint Laurent, avec la Tour Eiffel illuminée en toile de fond et un parterre de fleurs représentant le monogramme de la maison a ravi les spectateurs. Pourtant, le reste de la semaine a prouvé que le luxe pouvait prendre du recul avec le storytelling spectaculaire. Et plusieurs maisons ont pris le parti de revenir à plus de substance.
Balmain : une continuité, mais dans l’épure
La maison Balmain a fait de la flamboyance sa marque de fabrique. Et sous le mandat d’Olivier Rousteing, elle a retrouvé l’énergie vibrante que Pierre Balmain avait voulu insuffler à la couture, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Au début des années 2000, la Balmain Army était LE spectacle à ne pas manquer pendant la Fashion Week parisienne. Des femmes charismatiques, des lignes fortes, et une richesse dans les matériaux et les couleurs qu’on ne pouvait confondre avec aucune autre maison. Mais Olivier Rousteing ne souhaite pas se répéter. Et depuis le début d’année 2025, il pilote un virage stratégique chez Balmain. Une nouvelle ère qui s’est incarnée dans le défilé printemps-été 2025 présenté la semaine dernière.
Certes, la luxuriance est toujours là. Mais elle se fait plus discrète, plus minérale, avec des teintes plus soutenues et des matières plus douces. Exit l’armure de la Balmain Army. Olivier Rousteing travaille sur des lignes plus souples, et il ancre sa collection dans un récit inspirant de voyage. Il offre un contexte apaisé à la femme Balmain. Et il s’éloigne ainsi clairement de la stratégie du spectaculaire qui avait fondé le récit de ses premières années à la tête de la maison.
Hermès : le refus de la couture spectacle
Là où Balmain entame une transition, la maison de maroquinerie poursuit son chemin singulier dans l’univers du luxe. Et on la cite très souvent en référence absolue de la maîtrise des récits. Hermès n’affiche pas de stars hollywoodiennes dans ses campagnes publicitaires. Elle n’a que peu d’ambassadeurs. Et les défilés de la maison ne versent jamais dans le sensationnalisme pour affoler le compteur à buzz.
Cet esprit de rigueur dans le storytelling s’est encore retrouvé dans le dernier défilé féminin de la maison. Pour l’occasion, la collection Hermès défilait dans le cadre de la caserne de la Garde républicaine. Un choix en forme d’évidence pour une maison dont l’activité première est la sellerie. Dans un décor de sable, simplifié à l’extrême, la seule vraie star du spectacle, c’était le cuir bien sûr. Et Nadège Vanhee-Cybulski, la créatrice en charge des collections féminines, a pu laisser toute la place au matériau signature de la maison pour s’exprimer pleinement.
Ainsi mis en majesté, il convoque d’emblée l’histoire de Hermès (la sellerie, donc) mais aussi la richesse de son savoir-faire. Décliné en harnais, en jupes, en bottes et en sacs, le cuir donne à voir la parfaite maîtrise des artisans Hermès. Ainsi chez Hermès, la maison refuse systématiquement le spectacle. Mais pour autant, son storytelling n’a rien de pauvre. C’est la légitimité de son artisanat qui fonde la pertinence d’une histoire de confiance entre la maison et sa clientèle.
Chanel : le nécessaire équilibre entre spectaculaire et substance
Impossible de passer à côté des images du défilé Chanel, qui ont inondé les réseaux sociaux. Et le show cosmique sous la verrière du Grand Palais devrait faire date dans l’histoire de la Fashion Week de Paris, pourtant habituée au spectaculaire.
En amont du défilé, Chanel semblait pourtant avoir renoncé au faste des défilés Lagerfeld. Car ses premiers éléments de communication, très sobres, présentaient des photos noir et blanc épurées : une chemise, quelques vêtements sur un fauteuil Louis XV, la nuque d’une femme de dos. La surprise fut donc totale, à la découverte du décor constitué d’un système solaire imposant aux couleurs éclatantes.
Si Chanel a fait de ses défilés-spectacles une habitude, elle a pourtant opéré une mue intéressante. Car ce défilé Chanel, le premier sous la direction de Matthieu Blazy, n’a pas été éclipsé par son cadre. La raison ? La collection a choisi la substance, la richesse créative, ainsi qu’un retour aux sources que l’on n’attribuait plus forcément au style Chanel.
Après des années de répétition des canons imposés par Karl Lagerfeld, Matthieu Blazy a voulu renouer avec l’esprit de Gabrielle Chanel. Il a proposé sa lecture personnelle du vestiaire de la créatrice. Le propos était clair. L’exécution, rigoureuse. Et le succès vertigineux rencontré par ce défilé est peut-être autant dû à la richesse de la collection proposée qu’au spectacle de la scène.
Autrement dit, Chanel n’a pas choisi entre la stratégie du « dire » et du « faire ». Elle a tiré un trait d’union entre sa capacité à émerveiller et sa compétence couture. Une leçon à retenir dans un univers du luxe où la clientèle se lasse désormais des symboles vides de sens.
À lire aussi :