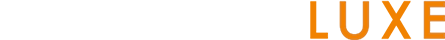|
|

|
|
Jean-Paul Gaultier demeure l’un des noms les plus puissants du patrimoine de la mode française. Un véritable symbole de liberté et d’audace qui a inspiré toute une génération de stylistes. Après avoir laissé les clés à plusieurs créateurs invités, la maison se relance. Et c’est Duran Lantink, un créateur néerlandais reconnu pour sa vision anti-consumériste, qui en est désormais le directeur artistique. Dimanche 5 octobre, il présentait sa première collection Gaultier avec le défilé printemps-été 2026. Et il n’a pas hésité à raviver l’ADN transgressif de la maison parisienne.
Anatomie d’un défilé qui ose
Le premier défilé de Duran Lantik pour Jean-Paul Gaultier ne laisse pas la place à l’ambiguïté. Et dès les premières silhouettes, on retrouve le pur esprit de la maison. Corps exposés, tissus seconde peau, jeux de trompe-l’œil, illusions anatomiques qui défient la notion de genre. Le ton est donné : la mode doit déranger.
Un body orange vif moulé jusqu’à l’extrême évoque autant les tenues sportives futuristes que les costumes fétichistes. Un ensemble noir gonflé d’air semble revisiter le concept de veste d’homme transformée en armure molle, sans pantalon pour la compléter. Un manteau blanc surdimensionné, aux volumes quasi sculpturaux, reprend la logique du cocon chère à Gaultier dans les années 1990.

Le corps devient un véritable terrain d’expérimentation visuelle, notamment avec ses effets de nudité et ses couleurs vibrantes. Si beaucoup de créateurs cherchent la grâce, Lantink préfère la tension. Et ce défilé s’affirme comme une confrontation entre le corps et le vêtement. Comme une mode de la friction.
Duran Lantink chez Gaultier : un héritier subversif
Si Duran Lantink apparaît comme un choix évident pour reprendre le flambeau de Jean-Paul Gaultier, c’est parce qu’il partage sa vision. Celle d’une mode fondée sur la liberté et le mélange des genres.
Le créateur a été révélé grâce à son approche sur l’upcycling. Et il a prouvé sa capacité à jouer avec les figures hybrides. Comme Jean-Paul Gaultier en son temps, Lantink refuse la hiérarchie entre « grande couture » et vêtement de rue. Il revendique une spontanéité proche du chaos, et un esprit ludique qui dérange la mode consensuelle.

Sa nomination à la tête de la maison française traduit une volonté de revenir à l’esprit punk des débuts Gaultier. Il ne s’agit pas d’une lecture patrimoniale qui se contenterait de revisiter les silhouettes iconiques de la marque. Lantink n’est pas le curateur d’un héritage. Il a la charge d’écrire la suite de l’histoire. Dans le monde des années 2020, saturé de codes, de filtres et d’intellectualisation, Duran Lantink remet au goût du jour le « beau bizarre ».
Retour au scandale : une mode qui refuse le consensus
Sa première collection chez Gaultier pose donc une question essentielle. Qu’est-ce qui peut encore choquer aujourd’hui ?
Dans le monde actuel de la mode, les codes du provocant ont été absorbés par la publicité. Les images sulfureuses deviennent virales avant même d’être comprises. Alors quelle place reste-t-il à la transgression dans la couture ?

Lantink semble répondre avec une nouvelle forme de transgression, qui repose plutôt sur un désordre sensible. Ses silhouettes jouent sur la confusion : peau ou tissu ? Homme ou femme ? Protection ou exhibition ? Ce n’est plus le scandale du nu, mais celui d’une forme de vulnérabilité exposée.
Et à sa manière, le créateur défend le besoin vital pour la mode de retrouver sa capacité à provoquer. Non pas par stratégie marketing, mais par conviction. Car si une forme de fatigue du luxe a fini par s’installer, c’est peut-être parce que les maisons elles-mêmes ont arrêté de surprendre.
À lire aussi :
- Jean-Paul Gaultier : une exposition entre mode et cinéma
- Alaïa et Maison Margiela : une couture de silence dans un luxe fait de bruit
- Sarah Burton chez Givenchy : renouer avec la culture de la couture française
- Loewe : l’héritage artisanal à l’heure du renouvellement identitaire
- Schiaparelli : Daniel Roseberry réaffirme le pouvoir de l’image
- Balmain : après l’audace, Olivier Rousteing ouvre l’ère de la maturité