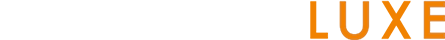|
|

|
|
L’ouverture de Shein au BHV a ravivé un débat brûlant : celui de la protection des marques de luxe face à la prolifération de copies vendues à prix dérisoires en ligne. Quelques jours avant l’inauguration, le porte-parole de Shein France niait toute contrefaçon sur la plateforme, invoquant même un prétendu « jeu des 13 erreurs » pour distinguer les produits litigieux des originaux. Une ligne de défense que réfute fermement l’avocate Vanessa Bouchara, spécialiste de la propriété intellectuelle, qui décrypte les critères juridiques applicables, le rôle exact des plateformes et les risques encourus. Un éclairage essentiel au moment où l’arrivée physique de Shein en France interroge directement l’écosystème du luxe et sa capacité à protéger ses créations.
Comment définit-on la contrefaçon d’un produit en droit français et européen ? Quels sont les critères retenus par les juges pour l’établir ?
Vanessa Bouchara – En droit français comme en droit européen, la contrefaçon désigne toute atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son titulaire.
Pour les marques, elle est caractérisée dès lors qu’un signe identique ou similaire est utilisé pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, et que cette utilisation peut faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public.
Pour les créations protégées par le droit d’auteur, la contrefaçon suppose la reprise des éléments originaux de l’œuvre, c’est-à-dire ceux qui traduisent l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Les juges apprécient concrètement la contrefaçon selon les ressemblances, en procédant à une comparaison d’ensemble entre les produits, en tenant compte de leurs éléments visuels, sonores et conceptuels, mais aussi du public visé et du contexte d’exploitation.
L’intention du contrefacteur n’est pas un critère.
Le “jeu des 13 erreurs” invoqué par Quentin Ruffat, le porte-parole de SHEIN France : a-t-il un fondement juridique ?
V-B – Non, cet argument ne repose sur aucune base légale. La contrefaçon ne se mesure pas au nombre de différences entre deux produits, mais aux ressemblances.
Même si un produit comporte quelques variantes mineures, il peut constituer une contrefaçon s’il reproduit la marque ou encore ce qui fait l’originalité ou la valeur d’une œuvre.
Autrement dit, changer quelques détails ne suffit pas à échapper à une sanction au titre de la contrefaçon. Les juridictions françaises sanctionnent régulièrement ce type de “reproductions habilement déguisées”.
Quelle est la responsabilité d’une plateforme comme SHEIN ?
V-B – Les plateformes qui hébergent ou commercialisent des produits peuvent voir leur responsabilité engagée à deux titres :
- en tant qu’intermédiaires techniques, lorsqu’elles n’ont qu’un rôle passif et se conforment aux obligations de retrait après notification ;
- en tant qu’acteurs économiques, lorsqu’elles participent activement à la sélection, la présentation ou la promotion des produits mis en ligne.
Dans le cas de SHEIN, les juges pourraient considérer que la plateforme ne se limite pas à un simple hébergement, mais organise et valorise elle-même la vente de produits, ce qui pourrait justifier une responsabilité directe pour contrefaçon ou, à tout le moins, pour complicité.
Les textes européens récents, notamment le Digital Services Act, renforcent d’ailleurs les obligations de diligence et de transparence des plateformes.
Quand parle-t-on de “parasitisme” plutôt que de contrefaçon ?
V-B – Lorsque la reproduction ne porte pas sur un signe ou une création protégée par un droit privatif (marque, brevet, droit d’auteur), mais qu’il y a reprise des investissements / du positionnement d’un acteur économique.
Le parasitisme sanctionne le comportement d’un acteur qui, sans investissement propre, se place dans le sillage d’une marque de notoriété pour profiter indûment de sa valeur et de ses efforts.
La différence réside essentiellement dans la nature du droit invoqué : la contrefaçon protège un titre juridique précis, tandis que le parasitisme repose sur le principe général de loyauté dans la concurrence.
Pourquoi est-il si difficile de poursuivre des plateformes du type de SHEIN ?
V-B –Cela n’est pas si difficile, il suffit de se faire accompagner et d’engager des actions pro-actives et régulières contre l’ensemble des acteurs portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Le chantier peut sembler complexe, et effectivement il l’est, il faut obtenir la preuve des agissements, il faut également agir vite et de manière efficace, mais c’est le seul moyen d’obtenir des résultats.
Quelles sanctions juridiques encourt SHEIN en cas de contrefaçon avérée ?
V-B – Sur le plan civil, la contrefaçon engage avant tout la responsabilité du ou des auteurs des actes litigieux, sur le fondement des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (pour le droit d’auteur) ou L. 716-1 et suivants (pour les marques).
La juridiction civile peut alors ordonner :
- la cessation des actes de contrefaçon, via des mesures d’interdiction immédiate, de retrait ou de destruction des produits ;
- la réparation intégrale du préjudice subi par les titulaires de droits, calculée en fonction des profits réalisés, du manque à gagner et du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de la marque ;
- et, le cas échéant, la publication judiciaire de la décision, destinée à rétablir la vérité auprès du public.
Les vendeurs tiers sont responsables lorsqu’ils commercialisent des produits contrefaisants.
Mais la plateforme peut également voir sa responsabilité engagée si elle joue un rôle actif dans la mise en ligne, la promotion ou la logistique des produits litigieux.
Les tribunaux apprécient au cas par cas le degré d’implication de la plateforme : lorsqu’elle se comporte comme un opérateur de marché plutôt qu’un simple hébergeur, elle peut être condamnée solidairement avec les vendeurs.
En droit pénal, la contrefaçon est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, montant pouvant être porté à 5 ans et 500 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée. Ces peines s’ajoutent à la réparation civile du préjudice subi par les titulaires de droits.
Vous pouvez nous expliquer précisément en quoi la prolifération des copies nuit à la création et à l’économie du luxe ?
V-B – La contrefaçon fragilise l’ensemble de l’écosystème créatif. Elle décourage l’innovation, détourne les investissements et dévalorise le travail des créateurs. Dans le luxe, elle altère aussi la perception du savoir-faire et de l’authenticité, deux piliers essentiels de ce secteur.
Au-delà de l’enjeu économique, la contrefaçon contribue à banaliser l’idée que la création serait librement réutilisable, alors qu’elle est le fruit d’une véritable créativité et d’investissements considérables.
Protéger la propriété intellectuelle, c’est donc préserver la valeur de la création, mais aussi l’intégrité culturelle et économique du luxe.
À lire aussi :