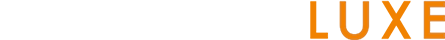|
|

|
|
En ce soir du 6 octobre 2025, une galaxie brillait sous la verrière du Grand Palais pour le défilé Chanel. Mais pour une fois, une chemise blanche a éclipsé les habituels tailleurs en tweed. Car pour sa première collection à la tête de la maison de la rue Cambon, Matthieu Blazy a choisi de faire un détour par la place Vendôme. C’est là, au cœur de Paris, que se trouve établi le plus ancien fabricant de chemises au monde. La maison Charvet, peu connue du grand public, a eu droit à un moment de gloire grâce au défilé Chanel. Et grâce à cette médiatisation exceptionnelle, elle connaît déjà un regain d’intérêt. À une exception près : car cette fois, ce sont les femmes qui s’intéressent à ce spécialiste de la chemise pour hommes. Retour sur l’histoire d’une maison française d’exception.
L’art de la chemise, né sous le Second Empire
C’est en 1838 que Christofle Charvet fonde sa maison, considérée comme le plus ancien chemisier au monde. Dès ses débuts, la maison parisienne s’impose comme référence grâce à la qualité de ses formes autant qu’au raffinement de ses matières.
À une époque où le vêtement masculin devient un marqueur d’élégance, et non plus seulement de statut, Charvet impose une grammaire du détail qui fera école. Des proportions équilibrées, des coupes ajustées, mais aussi et surtout des tissus exclusifs participent au prestige de la maison. Très vite, Charvet séduit les élites européennes, des écrivains aux hommes d’État, en passant par les dandys à l’instar du jeune Jean Cocteau.

Le secret ? Charvet est une authentique maison patrimoniale. Et son savoir-faire se transmet de génération en génération. Un artisanat d’exception qui confère à la maison un rang à part dans l’univers de la mode masculine. Et qui repose sur la conviction que la perfection n’est pas un idéal, mais plus simplement un geste répété depuis près de deux siècles.
Confection sur mesure
Au deuxième étage de la maison de la place Vendôme, c’est un ballet silencieux de coupeurs et d’artisans. Ici, tout commence par la « bûche » : le tissu choisi par le client, puis soigneusement coupé et préparé avant la confection. Dans l’atelier, ce tissu s’accompagne du patron et d’une liste précise d’instructions, à commencer par la prise de mesures du client pour obtenir une chemise parfaitement sur mesure.
La pièce la plus emblématique est le col, qui concentre le style Charvet. Une salle entière lui est d’ailleurs consacrée. Sur les murs, des dizaines de modèles exposent le savoir-faire de la maison pour cet élément qui demande beaucoup de précision. Longueur du rabat, hauteur de la bande, écart des pointes : chaque détail joue sur l’allure. Et comme le précise la maison Charvet, le choix du col est autant dicté par la morphologie du client que par sa personnalité. Un modèle unique de col est donc dessiné pour chaque client, puis affiné au fil des essayages. Et cet artisanat du col parfait demeure, encore aujourd’hui, l’élément signature de Charvet.
Chanel et Charvet : un dialogue entre passé et modernité
Lorsque Matthieu Blazy prend la direction artistique de Chanel, il décide d’explorer les archives de la maison. Parmi les notes et les photographies anciennes, une anecdote retient son attention. Gabrielle Chanel avait coutume d’emprunter les chemises de Boy Capel, son grand amour, qui se fournissait exclusivement chez Charvet.

Bien que la créatrice n’ait jamais intégré cette pièce masculine à ses propres collections, c’est ce fil intime que Matthieu Blazy a choisi pour trouver sa propre place dans l’univers esthétique de Chanel. Résultat : pour sa première collection, il noue une collaboration inédite avec Charvet autour de trois chemises féminines. Chacune d’entre elles est conçue à partir des tissus et des techniques de la maison.
Les chemises Charvet : stars du défilé Chanel
Même si la robe « piña colada » qui clôturait le défilé a été largement saluée, ce sont bien les trois chemises Charvet qui ont attiré tous les regards. En quelques heures, les amatrices de mode n’ont pas manqué d’inonder les réseaux sociaux avec les photos de ces trois créations. Un enthousiasme qui peut sembler surprenant puisque, traditionnellement, ce sont des tenues plus spectaculaires qui assurent le buzz pendant la Fashion Week. Mais n’est-ce pas la simplicité d’un vêtement « portable » par toutes les femmes, qu’importe leur morphologie, qui a justement suscité un tel engouement ?
Comme souvent en matière de couture, le secret se cache du côté de la confection. Et en intégrant les chemises Charvet à sa collection, Matthieu Blazy n’a pas seulement rendu hommage à la fondatrice de sa nouvelle maison. Il a fait dialoguer deux visions de l’élégance française : celle du tailleur et celle de la couturière. Rigueur et confort, liés ensemble par une même attention portée au savoir-faire.
Cette rencontre fait d’ailleurs écho à un autre moment de l’histoire. En effet, dans les années 1920, Gabrielle Chanel avait déjà collaboré avec Charvet pour les Ballets russes. Elle avait alors paré les danseuses de tuniques de jersey ceintes de cravates Charvet. Même paradoxe entre vestiaire masculin et silhouette féminine émancipée. Même complicité autour d’un raffinement technique au service de la mode moderne.
Charvet : une maison patrimoniale à l’heure du prêt-à-porter
Si l’apparition des chemises Charvet chez Chanel a enflammé les réseaux sociaux, c’est aussi parce qu’une telle collaboration reste rare. Auparavant, Charvet n’avait ouvert la porte de ses ateliers qu’une seule fois. En 2022, elle avait ainsi participé à une collection capsule, Gucci Vault, le temps d’une collaboration avec la maison de luxe italienne.

Charvet, bien que très ancienne et reconnue pour son excellence, demeure largement méconnue du grand public. Difficile équation pour une maison patrimoniale, que de rester visible dans un environnement médiatique où règne une fast-fashion qui ne correspond à aucune de ses valeurs.
En s’associant exceptionnellement à Chanel, Charvet rappelle que l’excellence a toujours sa place dans la mode actuelle. Et qu’au-delà des tendances, la vraie modernité réside peut-être dans la permanence du geste.
À lire aussi :